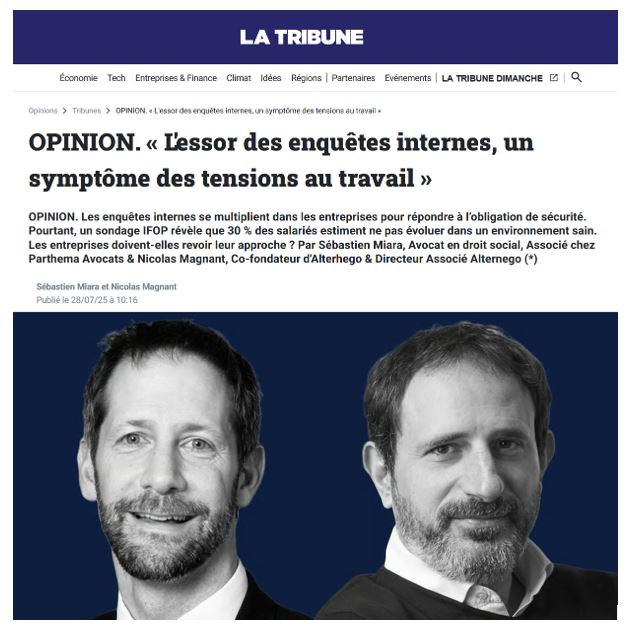Les enquêtes internes se multiplient dans les entreprises pour répondre à l’obligation de sécurité. Pourtant, un sondage IFOP révèle que 30 % des salariés estiment ne pas évoluer dans un environnement sain. Les entreprises doivent-elles revoir leur approche ? Par Sébastien Miara, Avocat en droit social, Associé chez Parthema Avocats & Nicolas Magnant, Co-fondateur d’Alterhego & Directeur Associé Alternego (*)
Depuis une quinzaine d’années, les enquêtes internes se sont imposées dans le monde du travail, portées par la libération de la parole, le développement des dispositifs d’alerte, et la montée en puissance de l’obligation de sécurité. Mais cette tendance s’inscrit aussi dans un climat dégradé : un sondage IFOP de mars 2025 l’illustre : 30 % des salarié(e)s estiment ne pas travailler dans un environnement sain et respectueux, symptôme de dysfonctionnements organisationnels et managériaux profonds, qui ne peuvent être traités uniquement à coups d’enquêtes internes.
Pour y répondre, les entreprises se sont structurées : formation de référents harcèlement, création de cellules d’écoute ou de départements « compliance ». Et lorsque les ressources internes sont insuffisantes ou que la situation est trop sensible, elles font appel à des experts externes – avocats enquêteurs, IPRP, cabinets d’audit ou de conseil.
Le respect de l’obligation de sécurité avant tout
L’enquête est souvent perçue comme le levier principal de conformité à l’obligation de sécurité de l’employeur, qui impose des mesures de protection physique et mentale (C. trav., art. L. 4121-1). Le respect de cette obligation ne suppose cependant pas nécessairemment une enquête si une réponse adaptée a déjà été apportée (Cass. soc., 12 juin 2024) ou si les faits sont suffisamment établis pour déclencher directement une procédure disciplinaire (Cass. soc., 14 févr. 2024). En somme, l’enquête est un moyen parmi d’autres, et non une réponse exclusive.
Des usages souvent problématiques
De nombreuses entreprises peinent à mettre en œuvre correctement une enquête, tant pour des raisons méthodologiques que budgétaires. Recourir à des prestataires extérieurs mal formés ou choisis hâtivement peut aggraver les situations.
De plus, l’enquête est souvent enfermée dans une approche réductrice et « qualifiante ». Or, un management toxique n’a pas besoin d’être juridiquement qualifié de harcèlement pour constituer un manquement à l’obligation de sécurité, voire justifier un licenciement. Enfin, dans certains cas, l’enquête peut aussi être instrumentalisée : pour riposter à un signalement ou se séparer discrètement d’un cadre devenu encombrant. Surtout, elle n’est jamais neutre : elle impacte le collectif de travail, déclenche des arrêts maladie, voire des départs.
Des signalements hétérogènes, des réponses à adapter
Les situations à l’origine des signalements sont extrêmement variées : mésentente, risques psychosociaux, discrimination, infractions, manquements éthiques… Les auteurs de signalements sont eux aussi divers (victimes, témoins, représentants du personnel, prestataires).
Il convient donc de prendre le temps de l’analyse avant d’enquêter, notamment pour distinguer les alertes professionnelles ou celles du CSE qui obéissent à des cadres spécifiques ou encore pour mesurer les enjeux et identifier les éventuelles alternatives.
Privilégier une lecture croisée et des réponses proportionnées
Une double lecture juridique et psycho-sociale permet d’évaluer objectivement les enjeux et de mobiliser les bons outils : médiation, accompagnement psychologique, diagnostic RPS, mesures conservatoires, etc. Autant d’alternatives ou de compléments à l’enquête qui sont aujourd’hui méconnues ou sous estimées.
Sortir du réflexe automatique et adopter une culture du discernement, structurée par des protocoles internes, constitue la marque d’une organisation mature. Cela passe par un renforcement des politiques de prévention, une réaction mesurée et adaptée à chaque situation, et un dialogue social qui soutient la transformation durable des organisations.
Choisir la justesse plutôt que l’automatisme
Face à l’inflation et à la diversité des signalements, il est indispensable pour les employeurs de faire preuve de discernement, d’adaptabilité et de maturité dans leur gestion des alertes. C’est dans cette dynamique que nous inscrivons notre action : aider les Directions à identifier les réponses les plus pertinentes face aux signalements, et, lorsqu’elles doivent être déployées, accompagner les entreprises dans des processus d’enquêtes structurés et responsables.
Sébastien Miara et Nicolas Magnant
______
(*) Maître Sébastien Miara est avocat associé en droit social au sein du cabinet Parthema Avocats, présent à Paris, Nantes et Rennes. Titulaire d’un DEA en droit social et d’un doctorat en droit privé de l’Université Paris II Panthéon-Assas, il a prêté serment en 2003. Spécialiste en droit du travail, Maître Miara intervient tant en conseil qu’en contentieux, notamment sur les aspects sociaux des restructurations, la compliance RH, les enquêtes internes, les relations collectives, les risques psychosociaux et les contentieux à enjeux. Il est également chargé d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon-Assas et à l’Université de Nantes, et publie régulièrement dans La Semaine Juridique – Édition sociale.
Nicolas Magnant est un spécialiste en sociologie des organisations et des sujets de QVCT (qualité de vie et conditions de travail). Titulaire d’un DEA en Sociologie des Organisations de l’Université Paris Dauphine, il a co-fondé et dirige AlterHego, cabinet spécialisé en prévention des risques psychosociaux et accompagnement des transformations depuis 2004 avant de rejoindre avec son expérience le groupe AlterNego (cabinet qui accompagne les entreprises pour mettre en œuvre leurs transformations et développer un climat propice au dialogue social) en en tant que directeur associé en 2023. Il a en outre notamment contribué à l’ouvrage collectif « La qualité de vie et des conditions de travail, l’affaire de tous ! » publié en 2024 aux éditions ESF.